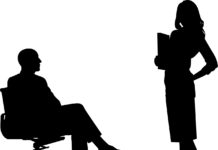chambre sociale
Audience publique du mercredi 23 septembre 2009
N° de pourvoi: 08-44062
Non publié au bulletin RejetM. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom , 10 juin 2008), que M. X… a été engagé par la Société d’économie mixte d’exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains (SEMETT) en qualité de masseur kinésithérapeute selon divers contrats à durée déterminée saisonniers, du 8 avril au 16 octobre 2002, du 7 avril au 25 octobre 2003 et du 5 avril au 23 octobre 2004 ; que préalablement à sa première embauche, l’intéressé a présenté à son employeur une « attestation de réussite au diplôme d’état de masseur kinésithérapeute » émanant de la préfecture de la région Auvergne, qui mentionnait que « la présente attestation n’autorise en aucune façon son titulaire à exercer la profession de masseur kinésithérapeute sur le territoire français » mais indiquait que « cette attestation est échangée contre le diplôme d’état de masseur kinésithérapeute dès que les intéressés remplissent les conditions exigées pour exercer la profession de masseur kinésithérapeute en France » ; que le salarié ayant posé sa candidature le 30 décembre 2004 pour un poste de masseur kinésithérapeute pour la saison 2005, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d’Auvergne a informé l’employeur que l’intéressé n’était pas autorisé à exercer la profession de masseur kinésithérapeute en France ; que le salarié ayant été licencié le 12 mai 2005, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de son licenciement, au titre du harcèlement moral et de rappel de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir dit le licenciement de M. X… non fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l’avoir condamné à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que l’employeur faisait valoir que si l’attestation de réussite au diplôme d’état de masseur kinésithérapeute présentée par le salarié préalablement à sa première embauche mentionnait certes que « la présente attestation n’autorise en aucune façon son titulaire à exercer la profession de masseur kinésithérapeute sur le territoire français », elle indiquait également que « cette attestation est échangée contre le diplôme d’état de masseur kinésithérapeute dès que les intéressés remplissent les conditions exigées pour exercer la profession de masseur kinésithérapeute en France », de sorte que la société SEMETT pensait qu’il suffisait de quelques démarches administratives pour régulariser la situation, et s’en est remise à M. X… pour l’accomplissement de sa démarche ; qu’en affirmant, au visa de la première mention de l’attestation de réussite au diplôme d’état de masseur kinésithérapeute, que l’employeur avait simulé une ignorance ou une interrogation quant à la capacité juridique du salarié à exercer en France la profession de masseur kinésithérapeute lorsque M. X… a déposé sa candidature pour la saison 2005, et qu’il ne pouvait dès lors invoquer cette incapacité juridique à l’appui du licenciement, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la seconde mention de l’attestation de réussite précitée n’avait pu induire l’employeur en erreur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-14-3 devenu L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que lorsque le salarié ne remplit pas les conditions légales ou réglementaires pour exercer la profession pour laquelle il a été engagé, l’employeur est en droit de le licencier, même s’il était informé de cette situation avant son embauche ; qu’en jugeant que la société SEMETT ne pouvait invoquer l’incapacité juridique de M. X… à exercer la profession de masseur kinésithérapeute à l’appui du licenciement, au prétexte inopérant qu’elle aurait eu connaissance de cette incapacité lors de l’embauche, la cour d’appel a violé l’article L. 122-14-3 devenu L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ que le juge ne peut affirmer que la cause véritable du licenciement n’est pas celle invoquée dans la lettre de licenciement sans établir avec certitude quel est selon lui le véritable motif de la rupture ; qu’en l’espèce, pour affirmer que le motif invoqué dans la lettre de licenciement ne constituait pas la véritable raison du licenciement, la cour d’appel s’est bornée à indiquer de façon hypothétique que « le véritable motif du licenciement, si tant est qu’il y a lieu de formuler des hypothèses, pourrait être appréhendé au regard de relations devenues très tendues entre le directeur et le salarié à compter de l’été 2004, notamment du fait des droits réclamés par le salarié » et a admis qu’il n’était « pas établi que le véritable motif du licenciement soit la contestation ou les conséquences du harcèlement moral » ; qu’en statuant ainsi, par des motifs qui n’établissent pas avec certitude la véritable cause du licenciement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 122-14-3 devenu L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, après avoir relevé que l’employeur avait en toute connaissance de cause décidé d’engager M. X… en qualité de masseur kinésithérapeute pour les saisons 2002,2003 et 2004, a constaté que le motif invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir l’incapacité juridique empêchant le salarié d’accomplir normalement ses tâches, ne constituait pas la véritable raison du licenciement et que le véritable motif résultait des relations très tendues entre le directeur et le salarié à compter de l’été 2004 du fait des réclamations de ce dernier ; qu’elle a ainsi, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et par des motifs non hypothétiques, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt d’avoir condamné la société SEMETT à payer au salarié des dommages intérêts au titre du harcèlement moral, alors, selon le moyen, qu’en présence d’échanges de lettres entre employeur et salarié comportant, de part et d’autre, des propos vifs et même blessants, les courriers de l’employeur ne peuvent s’analyser en un harcèlement moral ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’employeur et le salarié avaient échangé à compter d’août 2004 des courriers marqués par des citations, jeux de mots, commentaires sarcastiques et autres digressions sur un ton de plus en plus acerbe, qu’au début au moins directeur et salarié partageaient la responsabilité de ces échanges à fleurets mouchetés, et que M. X… avait, en répliquant systématiquement, contribué à provoquer ceux du directeur ; qu’en retenant cependant l’existence d’un harcèlement moral, au prétexte qu’il appartenait à l’employeur ou à son représentant de garder la tête froide et de maintenir les relations hiérarchiques dans un cadre strictement professionnel, la cour d’appel a violé l’article L. 122- 49 devenu L. 1152-1 du code du travail ;
Mais attendu qu’après avoir rappelé que selon l’article L. 1152 1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d’appel , par motifs propres et adoptés , a constaté que si des échanges épistolaires entre l’employeur et le salarié ont d’abord été courtois pour la période de septembre 2003 à janvier 2004, les rapports entre les intéressés se sont tendus à compter de l’été 2004 lorsque le salarié a demandé à bénéficier des dispositions conventionnelles sur les temps de pause comme les autres masseurs kinésithérapeutes, que devant l’insistance du salarié à revendiquer ses droits, le directeur s’est acharné inutilement sur lui en multipliant à son égard des allusions blessantes, que l’employeur avait fini par perdre toute mesure en reprochant des faits sans aucune justification et en alimentant une correspondance polémique par lettres recommandées au ton souvent ironique, voire blessant ou méprisant, marquées par des citations, jeux de mots, commentaires sarcastiques sur un ton de plus en plus acerbe, que le salarié avait en outre reçu deux avertissements pour des faits injustifiés qui avaient été annulés ; qu’en l’état de ces constatations , elle a pu décider que les agissements de harcèlement moral étaient caractérisés ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu’il est enfin fait grief à l’arrêt d’avoir condamné la société SEMETT à payer au salarié des dommages intérêts au titre du préjudice subi en raison des pauses non effectuées, alors, selon le moyen :
1°/ que l’exposante soulignait que le préambule de l’avenant du 6 octobre 2001 à l’accord d’entreprise du 6 mars 2000 explicitait son objet, à savoir la prise en compte des spécificités de l’activité des masseurs et de l’attrait des clients pour les masseurs, et qu’ainsi même si son article 2 ne réservait pas expressément le bénéfice de la pause rémunérée de dix minutes par heure aux masseurs, il visait néanmoins clairement l’acte de massage, qui nécessite un effort physique et génère une certaine pénibilité à l’inverse de la mobilisation en piscine effectuée par M. X… ; qu’en s’abstenant de prendre en compte le préambule de l’avenant susvisé pour rechercher son esprit et l’interpréter, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard dudit avenant ;
2 °/ que la fiche descriptive de l’activité « piscine » précise : « côté bassin, le curiste est sous la responsabilité du kinésithérapeute. Si celui-ci est absent : aucun curiste ne doit être laissé dans l’eau sans surveillance » et n’impose donc nullement la présence du kinésithérapeute lorsque le curiste est dans l’eau, mais prévoit au contraire spécifiquement l’hypothèse de l’absence du kinésithérapeute et prescrit seulement dans ce cas une surveillance qui peut donc être effectuée par un autre salarié ; qu’en affirmant que ce document mentionnait une présence obligatoire du kinésithérapeute lorsque le curiste est dans l’eau, la cour d’appel l’a dénaturé et a violé l’article 1134 du code civil ;
3 °/ que dans son attestation, Mme Y… précisait que les séances de mobilisation dans la piscine duraient quinze minutes, que les rendez-vous étaient planifiés toutes les vingt minutes et qu’il y avait donc cinq minutes de battement pour que les curistes sortent de la piscine, se sèchent et se rhabillent, et que le groupe suivant s’installe, et que c’était sa fonction et non celle du kinésithérapeute de s’occuper des curistes pendant ces opérations, de sorte que le kinésithérapeute disposait d’une pause de cinq minutes toutes les quinze minutes ; qu’en affirmant péremptoirement que cette attestation ne démontrait nullement que M. X… était en situation de pause rémunérée lorsque les curistes entraient et sortaient de la piscine, sans expliquer pourquoi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2 de l’avenant du 6 octobre 2001 à l’accord d’entreprise du 6 mars 2000 ;
Mais attendu qu’après avoir rappelé que selon l’avenant à l’accord collectif d’entreprise du 6 mars 2000, tous les masseurs kinésithérapeutes doivent bénéficier d’un temps de pause de dix minutes par heure rémunéré mais non comptabilisé dans le temps de travail effectif, c’est par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation de la fiche descriptive de l’activité piscine que la cour d’appel a estimé que cette activité mentionnait expressément une présence obligatoire du kinésithérapeute lorsque le curiste était dans l’eau, de sorte que le salarié, qui n’avait pas bénéficié des dispositions conventionnelles pour les saisons 2002, 2003 et 2004, avait subi un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant ; qu’elle a ainsi, sans devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SEMETT aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société SEMETT à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;
voir cet arrêt sur légifrance http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021084024&fastReqId=1136152030&fastPos=4